- Accueil
- Par terre et mer vers l'Ouest
Par terre et mer vers l'Ouest
PAR TERRE ET PAR MER VERS L'OUEST
J’aime trop la terre, cette surface entre deux abîmes… — Retour à l’araignée — La Chersonnèse de Chalcidique — L’Achéron et la porte des Enfers — Le Pélion — Béotie et Phocide — Tours et détours à travers le Péloponnèse — L’Arcadie — La Messénie et la Pylos des sables — Et Sparte ? — Petit discours olympique pour démontrer mon impartialité.
Par une sombre route déserte, / Hantée de mauvais anges seuls, / Où une Idole, nommée NUIT, / Sur un trône noir règne debout, / Je ne suis arrivé sur ces terres-ci / Que nouvellement d’une extrême et vague Thulé, / D’un étrange et fatidique climat qui gît, sublime, / Hors de l’ESPACE, hors du Temps. / Insondables vallées et flots interminables, / Vides et souterrains, et bois de Titans / Avec des formes qu’aucun homme ne peut découvrir / À cause des rosées qui perlent au-dessus ; / Montagnes tombant à jamais / Dans des mers sans nul rivage ; / Mers qui inquiètement aspirent, / Y surgissant, aux cieux en feu ; / Lacs qui font déborder incessamment / Leurs eaux solitaires, solitaires et mortes, / Leurs eaux calmes, calmes et glacées / Des neiges des lis inclinés, / Par les lacs qui ainsi débordent / Par les montagnes, près de la rivière / Qui murmure lentement, qui murmure à jamais, / Par les bois gris, par le marécage / Où s’installent le crapaud et le lézard, / Par les flaques et les étangs lugubres / Où habitent les Goules, / En chaque lieu le plus décrié, / Dans chaque coin le plus mélancolique / Partout le voyageur rencontre effarées / Les réminiscences drapées du Passé, / Formes ensevelies qui reculent et soupirent / Quand elles passent près du promeneur, / Dans les plis blancs d’amis rendus depuis longtemps / Par l’agonie, à la Terre et au Ciel. / Pour le cœur dont les maux sont légion, / C’est une pacifique et calmante région. / Pour l’esprit qui marche parmi l’ombre, / C’est –oh ! c’est un Eldorado ! / Mais le voyageur, lui qui voyage au travers, / Ne peut, n’ose pas la considérer ouvertement. / Jamais tel mystère ne s’expose / Aux faibles yeux humains qui ne sont point fermés ; / Ainsi le veut son roi, qui a défendu / D’y lever la paupière frangée ; / Et aussi l’âme en peine qui y passe / Ne le contemple qu’à travers des glaces obscurcies. / Par une sombre route déserte, / Hantée de mauvais anges seuls, / Où une Idole, nommée NUIT, / Sur un trône noir règne debout, / Je ne suis arrivé sur ces terres-ci / Que nouvellement d’une extrême et vague Thulé.
Edgar Poe, « Dream-Land » (The Raven and other Poems, 1845)
J’aime trop la terre, cette surface entre deux abîmes…
Au moment où je m’apprête à parler de ce que les Grecs considèrent comme le centre du monde, alors qu’il s’agit tout au plus d’une étroite péninsule environnée de quelques archipels, il me plaît d’ironiser. Les représentations de l’au-delà, qu’il se situe en Occident, comme le pensent les Égyptiens et la plupart des Grecs, en Orient, ou quelque part derrière les portes des Enfers que les tribus des Grecs revendiquent à qui mieux mieux, comme si c’était un titre de gloire, ne me préoccupent guère. C’est aussi vain que de rechercher le nombril du monde. Centre et périphérie, frontières qui bornent les empires et les sphères d’influence, tout se déplace au cours du Temps, tant il est vrai que la géographie a moins d’importance que les hommes, badauds, commerçants ou conquérants avec les hordes qu’ils entraînent à leur suite.
J’aime trop la terre, cette surface entre deux abîmes, pour éprouver le désir de descendre vivant aux Enfers, qu’il s’agisse des régions où vivent les favoris des hommes et des dieux ou du bourbier fangeux qui monte jusqu’aux épaules de ceux qui ont commis l’erreur de défier les dieux. Je ne puis dire ce que je fus autrefois si ma vie n’est qu’un passage parmi d’autres, lézard craintif qui se réchauffe au soleil, scolopendre agité d’un mouvement perpétuel, fuyard au temps de la guerre de Troie, patron d’un navire que son équipage a jeté par-dessus bord, homéride célébrant des exploits qui ne furent pas les siens… J’admire que Pythagore, le Samien devenu Crotoniate, cet oiseau migrateur qui voulut suivre la même route qu’Apollon quand il devint corbeau jusqu’à Métaponte, ou encore dauphin à travers les plaines de la mer vineuse, jusqu’à Delphes, le nombril supposé de la terre, puisse se souvenir de ce qu’il a vécu dans d’autres vies. Ulysse, Héraclès, Thésée, Aristéas de Proconnèse ont eu, si l’on en croit la légende, le courage de franchir les portes qui nous séparent des profondeurs de la terre. Empédocle, qui me fit l’honneur de me rendre visite, a payé de sa vie sa curiosité et son audace insolente. Perséphone partage sa vie divine entre le royaume invisible d’Hadès-Aidoneus et les plaines de Déméter baignées par la lumière du soleil.
Puisque j’ai suivi la course du soleil d’Orient en Occident, je sais que les Égyptiens, hantés comme nous tous par les interrogations sur le devenir du soleil quand il plonge dans l’invisible (est-ce toujours le même soleil qui se lève ou une épiphanie toujours renouvelée ?) croient qu’il accomplit une navigation souterraine d’Ouest en Est sur une barque. Mais je ne puis croire que le Soleil soit fatigué d’avoir brillé toute la journée et qu’il ait besoin de naviguer sous la voûte nocturne, où ne brillent que de pauvres luminaires, pour recharger son carquois et récupérer chaleur et vigueur. C’est pourtant ce que disent les poètes… et les Égyptiens. Homère nous dit dans l’Odyssée que les Phéaciens habitaient autrefois Hypéria qui rappelle un autre nom du Soleil, Hypérion, « celui qui parcourt les hauteurs », et certains détails peuvent faire songer à cette navigation nocturne, les vaisseaux sans pilote des Phéaciens et les frises émaillées de leur palais. Si Ulysse est le Soleil et si la servante de Nausicaa ne figure dans ce récit que pour être chassée comme l’obscurité au point du jour, faut-il situer le royaume des Phéaciens à l’Est ou à l’Ouest d’Ithaque ? Je n’y comprends plus rien, mais cela m’amuse et l’envie me prend de rapprocher la fuite de la servante de Nausicaa et le massacre des servantes d’Ulysse quand il fait briller le soleil de sa gloire à la fin du poème. J’entends encore la voix mélodieuse de mon oncle Panyassis qui récitait, sans s’accompagner de la flûte comme le poète de Colophon parce qu’il ne voulait pas choquer les puristes, les cagots et les bigots qui ne jurent que par la cithare, des vers de Mimnerme dont les ancêtres venaient de la Pylos des sables. Mimnerme racontait que le point d’aboutissement du voyage de Jason avant la conquête de la toison d’or avait été la ville colchidiennne d’Aiétès et de Circé, Aia qu’il situait en dehors de la terre des mangeurs de pain, sur les rives orientales de l’Océan. Il employait d’ailleurs un mot étrange pour désigner les rives, le mot « lèvres ». Le grand tout, Terre et Océan, ce fleuve marin qui l’entoure, serait-il une coupe étrange dont les bords seraient abaissés, ou un bol reposant à l’envers sur le vide infini ? En écoutant le poète, j’imaginais le Soleil renouvelant sa cargaison de rayons d’or et puisant dans l’arsenal de son palais ou dans les émanations ignées de l’onde amère, avant de voguer de nuit, mollement allongé sur la couche d’or forgée par Héphaistos où il se repose des fatigues du jour. Que devient cette couche qui a la forme d’une coupe pourvue d’ailes quand le Soleil s’est levé ? Eh bien, Panyassis avait la réponse, ou plutôt deux réponses. Le cours du fleuve Océan la ramènerait au point de départ, ou bien Héraclès l’aurait empruntée (ne devrait-on pas dire qu’il l’avait volée ?) pour naviguer vers Érythie et Tartessos, avec sa cargaison de bovins volés à Géryon. Mais ici les explications divergent et je ne vais pas perdre mon temps en tentant de préciser quelles étaient les relations entre Héraclès et Hélios (pire que Phaéton, il faut le faire !) et si Héraclès n’était pas tout simplement un soiffard fasciné par les cratères géants, en somme un pantagruel comme dirait le curé de Meudon.
Comme Ré, les pharaons voyagent dans les profondeurs de la Nuit que les Égyptiens appellent Nout, « dame du ciel et des étoiles, mère du Soleil ». Dès le début de son règne, le pharaon se préoccupe (sage précaution d’un pauvre mortel !) d’aménager les étapes de son parcours posthume en construisant les couloirs qui conduisent à la salle funéraire. De tout cela je comprends le sens, bien que j’aie peine à croire que Rhampsinite, le successeur de Protée, ait joué aux dés avec Déméter et que celle-ci lui ait fait don d’une serviette tissée d’or qu’il ramena sur terre, pour le féliciter d’avoir parfois gagné. L’Achéron roule sur l’or parce qu’il se nourrit de tous les mortels qui lui payent le tribut de leur quête insatiable. L’homme ne peut rien contre le temps qui joue comme un enfant, et les pépites que les hommes s’acharnent à collecter dans les fleuves qui roulent de l’or, Pactole ou ouadi de Libye, ne sont que poudre aux yeux. Pour ma part, si je rapporte ce qui se dit, par exemple l’histoire de Rhampsinite, si j’admets qu’un jour je doive comparaître devant Rhadamanthys qui a reçu pour mission de juger les Cariens et les autres habitants de l’Asie Mineure, si je suis intéressé par les rites de Samothrace et les croyances des Gètes qui se croient immortels, je ne conçois pas d’autre forme de survie que le souvenir de ceux qui m’ont aimé, l’admiration ou le mépris de ceux qui me liront, voire la persistance de mon corps éparpillé, quand mon souffle aura cessé d’animer mon enveloppe corporelle. C’est bien le sens des arguments qu’Euripide, le rival de mon cher Sophocle, attribue à Thésée quand il invite les autres personnages des Suppliantes à ne pas redouter que les morts viennent importuner les vivants ou ébranler les fondements de notre terre. Oh ! je sais bien qu’en Mésopotamie les mauvais rêves sont comme un souffle qui vient agresser le dormeur. Pourtant, quand les portes de la mort ont été franchies, il n’y a plus d’ennemi. Dès lors que votre ennemi est mort pour une raison ou pour une autre, vous lui devez le respect et ce précepte est l’un des fils rouges de mon Enquête.
Ce monde que je vois, il m’est difficile, il m’est douloureux d’imaginer qu’il puisse finir avec moi ou après moi. Quant aux Enfers, pour moi, cela commence quand je descends l’escalier moussu de la cave de ma maison. Mais je suis surpris qu’Ismaïl Kadare puisse affirmer que, somme toute, les Grecs ne redoutent pas trop les Enfers : Et, même s'il existait des représentations effrayantes de la fin du monde, elles ne devaient guère inquiéter les Grecs ; ils y étaient probablement moins sensibles qu'à l'enfer, qui leur était familier et qu'ils voyaient un peu comme la cave de leur maison. S’il en était ainsi, Achille ne serait pas aussi triste quand il songe à la mort. Nos grand’mères dépenseraient moins de salive à effaroucher les bambins en leur faisant visiter la chambre des supplices où croupissent les criminels.
Retour à l’araignée
Clothô file encore pour moi et Atropos n’a pas encore commis l’irrémédiable en m’obligeant à suivre le chemin sans retour. Mais les fileuses de ma cave me plaisent moins que celles qui préfèrent inlassablement tisser des liens d’un brin d’herbe à l’autre et attendre que la rosée du matin révèle la structure géométrique de leur travail. Pourquoi les femmes athéniennes tissent-elle un vêtement merveilleux pour la fête des Panathénées ? Pourquoi éprouvons-nous de l’inquiétude et de la répulsion quand nous rencontrons ces êtres vivants qui portent le nom d’Arachné, la fille d’un teinturier de Colophon, qui voulut rivaliser avec Athéna Ergané en représentant les amours scandaleuses des dieux ? Certes, Arachné est condamnée à la solitude parce que les araignées sont aussi solitaires qu’un vieux loup qui a quitté sa meute, ou un sanglier qui a congédié sa laie et ses marcassins. Mais elle ne s’arrête pas de travailler, et je considère qu’elle symbolise aussi l’activité humaine, hasardeuse et fébrile ou soigneusement organisée, que le pieux Sophocle a su célébrer dans son Antigone. Il faut donc aller chercher ailleurs les raisons de notre répulsion. Pour conjurer la peur de l’enfer, ce conte que m’a raconté un Nubien à la peau sombre suffira. Le début de ce conte n’est pas sans rapport avec le conflit entre Zeus et Prométhée.
Il était une fois un roi si puissant qu’il régnait aussi bien sur les animaux que sur les hommes (quelle était la catégorie la plus difficile à gouverner ? je me le demande). Il ne pouvait empêcher les hommes de savoir que le feu se cache dans les profondeurs de la terre, mais comme beaucoup avaient payé de leur vie leurs tentatives pour s’en emparer, il avait réussi à persuader ses sujets qu’il serait impie de s’approprier l’un des avantages dont jouissent les dieux. L’araignée descendit un jour le long d’un fil qu’elle avait tissé aussi solide qu’un câble de navire et revint avec le feu. Fatiguée par ce voyage, elle s’endormit. La mouche en profita pour lui dérober le feu qu’elle remit triomphalement au roi qui dut s’incliner et admettre que le monde entrait dans une nouvelle ère. Le peuple des araignées eut beau tendre ses pièges pour attraper les mouches. Il en reste encore beaucoup dans les latrines, dans les écuries, dans les chaumières et à la table des princes, qui profitent de la chaleur du foyer et viennent se nourrir de ce que les êtres vivants laissent derrière eux.
Puisque je suis en train de célébrer l’araignée, je vais te raconter une histoire que Jean-Loïc Le Quellec m’a permis d’enrichir. En 1793, un jeune Vendéen poursuivi par les Républicains se réfugia sous les Pierres Garatelles, près du bourg de Vairé. C’est alors qu’une araignée recouvrit de sa toile son refuge. J’ajoute que ces pierres ont une origine assez mystérieuse. Il était une fois un ange qui osa défier le diable au jeu de ménjhe (un jeu de palets qui se pratique encore en Vendée). Le diable, vexé de n’avoir pu triompher, renversa les pierres que l’on appelait Pierre Dormante, Meinje ou Palet du Diable. Malheureusement l’extension d’une carrière a fait disparaître le palet.
Au centre de sa toile, l’araignée peut se croire maîtresse du monde et tirer les fils de sa destinée, comme notre âme sise au cœur des ramifications qui constituent notre enveloppe corporelle. Mais elle n’est pas plus libre que nous ne le sommes, elle est prise dans les liens qu’elle a elle-même tissés. Toujours inquiète, toujours en quête d’une proie, comme la plupart des hommes, ceux du moins qui ne sont pas sages. Le vent, la pluie, les proies elles-mêmes et les pas des hommes menacent son ouvrage. Pourtant, quand tu admires à contre-jour au petit matin ce que vous appelez les « fils de la Vierge » (Arachné, la rivale d’Athéna Parthenos !), ces câbles qui sustentent un voile délicat, aussi parfaitement rond et brillant que les disques de musique que vous appelez CD, les minutes que tu passes à contempler te font oublier le temps qui passe.
Aujourd’hui ma mémoire se trouble et des images disjointes se bousculent dans ma pauvre tête. Je ne parviens pas à rétablir la chronologie de mes errances. Dans mon Enquête, je n’ai pas jugé utile de décrire les lieux dont je vais te parler, parce que les Grecs les connaissaient un peu mieux que les pays plus lointains, et surtout parce que je n’écrivais pas un guide pour le voyage, une Periégèse.
La Chersonnèse de Chalcidique
En Chalcidique, j’ai vécu des instants de repos que je n’oublierai jamais. Dans la presqu’île de Sithonia, la plus sauvage de cette péninsule à trois branches, j’ai planté mon abri dans une roselière. Tous les matins, sur un chemin bordé de pieux où se perchaient les freux, une espèce de corbeau noir et blanc à la fois, dont le bec est plus court et plus massif, passait un troupeau de chèvres et de bovins. Point de chant du coq pour me réveiller, mais le chant des grenouilles, le souffle d’un bovin qui reniflait ma tente et les modulations diverses de la voix du berger qui parlait à chacun de ses animaux la langue qui lui convenait, comme un nomade dans le désert de Mongolie, ou comme un Indien dans les plaines de ce que vous appelez le Nouveau Monde. J’ai trouvé plus sauvage que moi, un vieil escogriffe dépenaillé venu d’Angleterre qui vivait comme un Troglodyte (je parle des peuples et non des oiseaux qui portent le même nom). Il savait sans doute parler à l’oreille des chevaux et converser avec les loups. Mais, pour ma part, je préférais rejoindre, avec ma compagne, les pêcheurs du village de Siviri pour déguster avec eux éperlans et rougets. Je comprends que l’exilé Milon (rien à voir avec Milon de Crotone !), dans une lettre adressée à Cicéron qui n’avait pas réussi à le faire acquitter, le félicite ironiquement d’avoir échoué et de lui avoir permis de manger d’excellents rougets dans un caboulot de l’Estaque. C’est du moins ce que raconte malicieusement Dion Cassius dans son livre 38, dont mon traducteur prépare l’édition pour une collection assez chouette, sous le patronage de Guillaume Budé. Mais j’apprends que des visiteurs venus du grand Nord, comme des tournesols qui aspirent à la lumière, ont construit des palaces dans la presqu’île de Pallène.
L’Achéron et la porte des Enfers
Revenons à l’Achéron dont j’ai visité la plaine et parcouru les méandres entre Glyki et Ephyra. Un arc-en-ciel magnifique jetait un pont entre deux noirceurs, celle des nuées orageuses et celle du seuil des Enfers, tout proche des cités des hommes et néanmoins invisible, en tout cas pour moi. La localisation de l’entrée des Enfers est si variable, pour nous en tenir à ce que disent les Grecs (Hermione, Trézène, le cap Ténare, Phigalie, mais surtout le Ponant du « continent » grec, encore que ce ne soit pas constant, puisque le pays des Cimmériens d’où vient le souffle de Borée conviendrait tout aussi bien), que je ne suis sûr de rien et que je m’en tiendrai aux impressions qui furent les miennes. Si l’horizon du monde d’en bas est une prairie d’asphodèles, comme le dit l’aède, je me souviens de celles que j’ai cru reconnaître dans les fossés de la route de Martinet à Aizenay en Vendée et de celles d’Halicarnasse. J’espère que ma science botanique n’est pas prise en défaut. Je ne crois pas que les colons de Trézène qui, dit-on, fondèrent ma patrie d’Halicarnasse les aient ramenées des Enfers. Je puis en témoigner, les eaux du fleuve (ou des fleuves, autre incertitude) ne sont pas pestilentielles au point qu’il n’y ait point d’oiseaux, et je suis sûr que les oiseaux ne se laissent pas empoisonner par les joncs ou par la nielle. Cette belle fleur, à cinq sépales roses, Agrostemma githago ou « nielle des blés », porte le même nom qu’une maladie provoquée par un champignon. Je te renvoie à l’article niger du Dictionnaire de l’Académie Française de 1694 : « Certaine broüée qui s'attache aux bleds déjà en graine, & qui les noircit », et à de nombreuses mentions chez les Prophètes et dans le Deutéronome. Quoi qu’il en soit, la fleur n’avait pas bonne réputation. Au Moyen Âge, elle passait pour provoquer le « mal des ardents » ou « feu sacré ». Dans la Bible, ce nom est associé à celui de la « rouille » et signifie malédiction et famine. Pourtant, dans le Centre de la France, on jetait des pieds de nielle pour se protéger du Malin. On l’appelle aussi « attrape-mouche de nuit », « fleur de coucou », « œillet des champs », « agrostemme à savon ». Les graines sont toxiques et provoquent chez les animaux des troubles nerveux par hémolyse. La plante a tellement subi l’agression des herbicides qu’il a fallu créer une réserve dans le Maine-et-Loire. Mais les flamants roses qui rejoignent au cours de leurs migrations les rives de la Mer morte ou d’autres lagunes dans la presqu’île de Giens, ou les hirondelles qui viennent prélever un peu de cette eau saumâtre pour cimenter leurs nids ne se laissent pas effaroucher. Comment pourrait-on reconnaître, en voyant les méandres de l’Achéron comme je les ai vus du haut d’une colline, le fracas des « deux fleuves tonnants » qui parvint aux oreilles d’Ulysse ? Mes guides se contentèrent de me faire remonter le cours du fleuve jusqu’aux gorges où les eaux disparaissent, ce qui n’a rien d’extraordinaire et ne nécessite pas l’intervention de Poséidon.
Le Pélion
Le Pélion, d’où partit Jason, est une des plus belles régions que je connaisse en Grèce. Je redoute que les guettes rocheuses du Pélion et de l’Ossa soient un jour inaccessibles au promeneur parce que les soldats auront décidé d’y implanter des garnisons pour surveiller le golfe d’Iolcos. Je suppose, comme Philon le Juif dans son traité De la confusion des langues, que le poète de l’Odyssée (XI, 315), en parlant des Géants qui voulaient entasser Olympe, Ossa et Pélion pour défier les dieux, a voulu tourner en dérision l’orgueil des hommes. Dans cette région reculée, les arbres, platanes et châtaigniers, résisteront sans doute à l’écobuage pratiqué par les bergers et aux coupes des forestiers qui préparent le bois pour les marchands de meubles et les charpentiers de marine. La forêt descend jusqu’aux falaises qui surplombent de petites plages comme celle de Milopotamos. Tu sais que je me plais à évoquer ce que les lieux sont devenus au fil des siècles. Eh bien, je ne suis pas étonné que la région ait servi d’asile pour échapper aux conquérants venus d’Asie et que, dans les villages de Milees et Tsangarada, on trouve de petites bibliothèques qui abritent de vieux grimoires et permettent de préserver les traces d’une paideia immémoriale.
Béotie et Phocide
Parce que mes guides me recommandaient de ne pas suivre la route de l’armée de Xerxès par le sentier montagnard de l’Anopée, afin d’éviter certains routards désargentés qui n’auraient pas manqué, selon mes guides, de me détrousser, j’ai préféré longer le détroit de l’Euripe. Si tu connais la région, il te sera sans doute difficile d’imaginer que le défilé des Thermopyles, qui doit son nom à des sources chaudes, était aussi resserré quand le lion Léonidas résista à l’armée de Xerxès. En effet, l’ensablement du golfe Maliaque a fait reculer le rivage vers l’Est. À partir d’Orôpos lieu de sinistre mémoire pour tous ceux qui ont connu la Grèce des spadassins colonels, puisqu’ils y avaient implanté l’un des camps où ils enfermaient les résistants, j’ai préféré rejoindre la Béotie. C’est en Béotie que j’ai mangé les meilleurs légumes et le meilleur fromage de brebis. Je me souviens du boucher de Platées qui avait la naïveté ou l’honnêteté de vendre le gigot d’agneau au même prix que l’épigramme, et les anguilles du lac Copaïs ont fait mes délices. Les Athéniens eux-mêmes, qui présentent les Béotiens comme des rustauds ignares, savent profiter des ressources de ce pays et se libérer de préjugés tenaces pour rendre hommage à Hésiode et à Pindare. Un jour, les fonds limoneux du lac seront exploités par les paysans et les ruines de Gla, dont l’origine remonte dans la nuit des temps sans que je puisse en dire davantage, étonneront les visiteurs.
Avant d'arriver en Phocide, j'ai rencontré quelques survivants de l'armée perse qui, après le désastre de Platées, n'avaient pu rattraper les fuyards. Ils se cachaient dans des ravins boisés où ils subsistaient vaille que vaille en rançonnant quelques pèlerins qui se délestaient de quelques vivres pour avoir la vie sauve. Apparemment, les peuples voisins connaissaient l'existence de ces apprentis larrons, mais ils ne semblaient guère s'en préoccuper, sans doute parce que leurs victimes n'étaient pas des villageois du cru, mais des pèlerins qui devaient s'attendre à ce que leur bourse devînt plus légère. En effet, une fois parvenus au sanctuaire de Delphes, il leur fallait payer un droit d’entrée pour honorer les dieux et engraisser ses serviteurs. À ces malheureux rescapés que j'ai interrogés je dois quelques souvenirs qui me permettent de voir la guerre du côté des vaincus (IX, 15 avant la bataille de Platées). Certains d'entre eux avaient pu se tirer d'affaire lors des combats de l'Artémision et se réfugier sur quelques madriers pour échapper aux flots en furie.
Mais ici l'histoire bifurque, comme se plaisent à le dire les conteurs traditionnels du pays bordé par la Grande Muraille. Ou plutôt c'est moi qui lui fais faire un grand bond en avant puisque j'accepte bien volontiers, à la demande de mon honorable traducteur, d'insérer ici une histoire bien étrange qu'il a lue le 28 juillet 2004 dans un journal dont je traduis le nom, Eleutherôsis (Libération). Dans l'Agora du terminal 1 de Roissy-en-France, un paradis pour les oiseaux mécaniques qui défient le ciel, un Iranien de 59 ans, exilé de son pays où règnent des prêtres fanatiques, a élu domicile depuis seize ans et refuse de quitter les lieux. Il ne voulait pas de la Belgique qui lui accordait le droit d'asile et, la perfide Albion lui refusant le passage du Channel, il a fait trois mois de prison à Boulogne-sur-mer. Tout allait s'arranger pour lui, mais il a refusé de signer les papiers pour obtenir un titre de séjour en France, tout en déclarant qu'il s'appelait Sir Alfred Mehran et qu'il n'était pas iranien. Dès lors il n'intéresse plus les bonnes âmes, ni les organisations qui plaident pour les réfugiés politiques. Mais c'est tout de même un cas que les Diafoirus du corps et de l'âme surveillent avec la plus grande attention. Les vicissitudes de l'histoire et la bêtise des États ont fait glisser cet homme vers la folie. Il ne parle plus sa belle langue, mais une espèce de sabir apatride qu'il prend pour de l'anglais, et se nourrit de fast-food, alors qu'il pourrait découvrir l'alose au beurre blanc, la raie torpille beurre noisette, le magret de canard aux pêches de vigne... S'il apprécie d'être élégamment vêtu grâce aux boutiques de fringues de l'aéroport et aux dollars de Steven Spielberg qui doit faire de lui le héros d'un film, un homme aussi apatride sur cette terre qu'un habitant de Mars, tellement il s'est dépouillé de son identité, tellement ses frères en humanité ont tout fait pour qu'il s'oublie, il se peut qu'il rêve d'un film qu'il ne verra jamais. Ainsi font, font les marionnettes … quand la divinité, à laquelle les hommes apportent leur concours sans barguigner, s'amuse à transformer de pauvres bougres en héros dérisoires.
Lors de ma première visite à Delphes, j’ai choisi de suivre le chemin des Perses pour bénéficier, dans le village d’Anémoreia (aujourd’hui Arachova) d’une vue plongeante sur la vallée du Pleistos et le sanctuaire. Dans le village où reposent les morts, j'ai passé, ma foi, une excellente nuit ! J'avais choisi d'y dormir parce que la nécropole est un peu à l'écart de l'enclos consacré à Apollon, ce qui me permettait de ne pas être importuné par l'agitation des pèlerins et les piaillements des badauds. De cette guette rocheuse, je pouvais découvris toute l'étendue du sanctuaire, le temenos de Marmaria tout au fond de la vallée, la mer d'oliviers de la plaine de Crisa et le golfe d'Itéa où je devais prendre une barque pour passer dans le Péloponnèse. Le soleil couchant jetait ses derniers feux comme s'il voulait enflammer les deux rochers de Delphes, Rhodini devenue aussi belle qu'une rose des sables, et Phlemboukos aussi rougeoyante que les braises du feu de la forge quand il est ranimé par le soufflet. Un vent glacé descendant du Parnasse avait balayé les nuages et les bourrasques de neige de la veille. Le Pleistos, au fond de son ravin, roulait des flots abondants de cascade en cascade et Castalie dispensait sans avarice son eau purificatrice. Dans la nécropole, je n'ai pas vu les tombes des soldats perses qui furent écrasés par les rochers que l'on m'a montrés, ou taillés en pièces par les héros Autonoos et Phylakos à moins que ce ne soit tout bonnement par des Delphiens subitement animés d'un esprit de résistance… Je suis sûr que les Delphiens ont fait ce qu'il devaient faire, réserver un emplacement pour leur sépulture, sans leur faire l'honneur d'un tertre dûment identifié par une inscription quelconque. Point trop n'en faut tout de même ! Mais les enfants, qui jouent à la guerre comme tous les enfants du monde et miment le sauvetage miraculeux du sanctuaire, m'ont affirmé qu'ils avaient trouvé dans un petit souterrain des ossements aussi gigantesques que ceux d'Oreste, et que le plus gros de tous les rochers que les divinités protectrices avaient fait basculer abritait le dernier repos d'un Immortel, c’est-à-dire d’un Perse choisi par le Grand Roi pour faire partie de cette garde que l'on voit défiler sur les murs de ses palais. Mon traducteur me dit que, dans les cours et dans les souterrains du Lycée Banville à Moulins, une bande de gamins et de gamines partait à la recherche des soldats allemands dont ils voyaient un engin délabré (Jeux interdits !).
Voulant tirer le meilleur profit d'une visite un peu courte, j'ai failli ne pas être au rendez-vous prévu avec le passeur qui devait me conduire sur l’autre rive du golfe de Corinthe à Aigai, d'autant plus que mon ânesse entra en rébellion, dès qu'elle eut compris que j'avais l'intention de sortir des chemins battus et de couper tous les virages d'une route déjà bien escarpée. Il m'a fallu mettre pied à terre, tirer par le licol la créature obstinée dont les yeux malicieux disaient assez bien le plaisir qu'elle prenait à me voir glisser sur les fesses, m'empêtrer dans le maquis des térébinthes et des genévriers. Elle gesticulait frénétiquement pour se débarrasser de mon pauvre barda.
Tours et détours à travers le Péloponnèse
J’ai failli me laisser séduire par le tohu-bohu de la mégapole corinthienne et de ses deux ports jumeaux, Léchaion tourné vers l’Ouest et Kenchréai, sur le Golfe Saronique, face à l’Asie Mineure. Wheeler raconte si bien mon séjour dans cette ville (p. 71 et suivantes) que je pourrais poursuivre mon chemin sans m’attarder. Mais je ne résiste pas au plaisir de donner un exemple des plaisanteries dont j’ai été gratifié et qui viennent souvent du fond des âges, avant de trouver une nouvelle jeunesse dans d’autres cultures. « Un quidam rencontra une tête d’œuf et lui dit : ‘L’esclave que tu m’avais vendu est mort’. L’autre répondit : ‘Par tous les dieux, quand il était avec moi, il n’a jamais fait cela. » Dans le même recueil, intitulé L’ami du rire (Philogelos), tu peux aussi lire ceci : « Une tête d’œuf voulait aller au lit. Comme il n’avait pas d’oreiller, il ordonna à son esclave de lui apporter un vase de terre cuite. Comme l’esclave lui disait qu’un vase était bien dur, il ordonna de le remplir de plumes. » Si vous dites qu’aucun mot grec ne correspond vraiment à ce que vous appelez l’humour, reconnaissez tout de même que nos pique-assiettes, esclaves ou philosophes ont l’esprit assez agile (eutrapeloi) pour nous faire rire et réfléchir. Beuveries symposiaques, railleries des marginaux de toute espèce, conversations débridées chez le barbier ou récits plus instructifs, visites d’échoppes diverses où les marchands corinthiens entreposent toutes sortes de marchandises, y compris des œuvres d’art. J’apprécie particulièrement le commentaire de Wheeler à propos de ce capharnaüm d’images divines jonchant le sol, de gorgones et de trépieds. Effectivement, il a fallu que je surmonte un sentiment d’horreur sacrée devant un tel désordre et certains propos philosophiques me reviennent en mémoire, ceux de Xénophane et d’Héraclite qui se refusent à confondre les dieux et leurs images. Pour autant, je profite de l’occasion pour regretter une fois de plus que les biens culturels de ce genre soient considérés comme de vulgaires marchandises. Je préférerais qu’ils demeurent dans les cités qui les ont vu naître, à condition bien sûr qu’ils soient conservés dans de bonnes conditions.
Sur l'Isthme de Corinthe, à l'endroit où se célèbrent les Jeux, je fis une rencontre bien curieuse. J'ai bien cru que les génies du lieu se livraient à leurs fantaisies ou que les vapeurs d’un état maladif, qui était la conséquence d’une hospitalité trop généreuse et me donnait des vertiges, ne s'étaient pas encore dissipées. Toujours est-il que des effluves de poésie pindarique venaient faire sonner les petits os de mes oreilles. C'est alors que je découvris, sur les degrés d'un temple, un jeune exalté qui n'avait pas besoin de se faire escorter par une bibliothèque, tant il s'était entraîné à déclamer du Pindare dans le pays de l’Oncle Sam. Pendant quelques jours, il fut un compagnon de voyage un peu étrange qui ne parlait pas de la pluie et du beau temps, ni de ce que nous allions manger. Mais ce que nous voyions le faisait sortir de temps à autre de son silence méditatif et chanter quelques vers bien choisis pour l'occasion. Comme d'autres dont on dit qu'ils vivent de l'air du temps parce que leur âme n'est effleurée par aucun souci, il lui suffisait de mâcher et remâcher les consonnes et les voyelles savamment agencées par le poète. Qu'est-il devenu ? Je ne sais. Est-il retombé les pieds sur terre ? S'est-il dit qu'il pouvait lui aussi composer ? Si j'avais le pouvoir de déterminer son avenir, voilà ce que je lui souhaiterais.
J'aime bien que la conversation s'interrompe assez souvent au cours d'une marche. C'est une bonne manière que nous devons à nos compagnons et à nous-mêmes si nous voulons faire en sorte que nos pensées intimes demeurent secrètes, profiter du spectacle de la nature et ne pas effaroucher les animaux et les oiseaux qui font partie du plaisir de la randonnée. Un marcheur, c'est un spectateur qui n'a pas besoin du privilège de la proédrie pour siéger au premier rang. Pour un temps, il a choisi de n'être ni viandard, ni prédateur, ni cueilleur, ni même collectionneur comme vous l'êtes parfois, par manie ou pour les besoins de la science. Il ne prélève pas, il se contente d'observer sur place. Les fleurs coupées perdent bien vite leur éclat, les insectes et les animaux sauvages que l'on enferme dépérissent bien vite parce que l'on ne sait pas les nourrir comme il faut et parce qu'ils ont été privés de la liberté essentielle, celle de se mouvoir comme bon leur semble. Sans doute la nature s'est-elle bien appauvrie dans vos contrées pour que vous éprouviez le besoin de conserver les traces d'une vie sauvage disparue chez vous et encore présente au loin. Si vous m'objectez que l'homme est le véritable roi des animaux, que son pouvoir de domestication n'a pas de limites fixées une fois pour toutes et que certains animaux, faisans, serins, perruches, perroquets et même sangliers, s'accommodent fort bien de se rapprocher des hommes, je vous répondrai qu'il est tout de même absurde d'élever de petits crocodiles pour les rejeter dans les égouts de Paris quand ils deviennent encombrants, je vous demanderai de comparer la noblesse d'un félin ou d'un loup qui vivent libres et la décrépitude de leurs congénères quand vous les enfermez, poil triste et pelage pelé, les yeux pleins d'une nostalgie qui fait peine à voir.
Une fois débarqué dans le Péloponnèse, j'ai longé la côte et visité Sicyone, la ville où l'on peut, sans grands risques, affirmer que la tragédie est née (je te renvoie à ce que j'en dis en V, 78) et Phlionte en suivant le cours de l’Asopos. Je me souviens d'un campement dans un lieu qui porte aujourd'hui le nom de Château de bois (Xylokastron) et des citrons que j'ai dérobés dans un verger pour calmer ma soif. Jamais je n'ai couru plus vite de ma vie que quand le propriétaire des lieux, noueux comme un cep de vigne et chaussé, semble-t-il, de bottes de sept stades, s'est mis à me poursuivre, armé d'un gros bâton de cornouiller. Régime intempérant ou conséquences de la chaleur qui s'installa, je fus malade pendant quelques jours, incapable de bouger sinon pour aller dormir sur la grève en attendant que la brise matinale fasse danser et chanter les vagues.
Sur ma route vers l’Arcadie, en quittant l’Achaïe, j’ai salué du regard le Cyllène et la montagne Chélydoréa dont le nom provient de la carapace de tortue utilisée par Hermès pour construire la première lyre. Tu connais cette montagne sous le nom de Mavrovouno, qui signifie Montagne Noire. Le premier inventeur de la lyre était-il encore un enfant, comme le dit l’Hymne à Hermès, ou un adulte aidé par un mortel, comme le dit Terpandre, un poète lyrique ? Cette deuxième version est attestée dans les fragments du poème perse que je cite à propos de Parthénopé. Ensuite, j’ai traversé les marais verdoyants de Lerne où l’hydre tuée par Héraclès se lovait sous un platane, à proximité de nombreuses sources qui seraient des résurgences de l’eau qui se déverse dans la plaine de Mantinée. J’espère que les voyageurs de l’avenir pourront, comme je l’ai fait à Lerne sans disposer des connaissances qui m’auraient permis de démêler le chaos des ruines et des constructions plus récentes, imaginer ce qu’étaient les maisons des temps anciens en voyant la Maison des Tuiles. Près de Phlionte, se trouve Némée où nous retrouvons les traces d’Héraclès revêtu de la peau du lion qu’il vient de tuer. Sur le stade où se déroulaient tous les deux ans des jeux, j'ai osé défier à la course un de mes compagnons de voyage et ma compagne qui se prenait pour Atalante. J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer cette femme qui refusait la domination des mâles et les Arcadiens prétendent retrouver sur leurs chemins les pistes sur lesquelles elle lançait un défi aux hommes. Il faut croire que le sang d'Hercule, ce vin rouge bien épais dont nous avions abusé la veille au soir (krasi kokkino, comme disent les boutiquiers que tu fréquentes), avait des vertus suffisantes pour faire de nous des athlètes capables de contourner la borne pour revenir au point de départ. Je n'ai pourtant pas l'habitude de me laisser griser par les vivats de la foule en délire.
L’Arcadie
Me voici en Arcadie, le pays des Géants, de Pan et des bergers bienheureux ! Avant de quitter la plaine de Tégée, sachant que la route serait difficile, j'ai demandé s'il y avait dans la cité un cordonnier suffisamment patient et diligent pour me confectionner une selle et un arrimage plus stable et plus solide. J’avais les mêmes problèmes que Stevenson dans les drailles des Cévennes, ces pistes interminables dans les éboulis. Les ruades incessantes de mon ânesse, à qui j'avais donné le nom de Glykeia (tu peux traduire par Dulcinée, mais sans te laisser aller à des suppositions malveillantes me concernant), avaient eu raison des lanières de cuir et un simple rafistolage n'était plus de mise. L'artisan fit un merveilleux travail au point que j'ai tout conservé, accroché sous ma tonnelle, et il me suffit de jeter les yeux sur cet attirail poussiéreux pour que surgissent les souvenirs de mes voyages.
J’avais en tête le patrimoine légendaire des Arcadiens, y compris ce qu’ils disent de la naissance de Zeus. Je préfère croire pour une fois que les Crétois n’ont pas menti quand ils la situent chez eux, sur le Mont Ida, mais je comprends que cette Grèce profonde, protégée sans doute par un cercle de montagnes, l’Érymanthe, le Cyllène, le Ménale et le Lycaion, ait, mieux que d’autres, su préserver les anciens principes de frugalité et d’hospitalité. Ici plus qu’ailleurs, nous parviennent les échos assourdis, déformés mais surtout enrichis, de l’Odyssée de notre espèce, du passé de l’humanité du fond des âges, celle qui vivait dans l’angoisse des lendemains à la sortie de l’hiver quand les provisions s’épuisent. Pour se convaincre que ce vieux monde est régénéré à chaque printemps et entraîné dans l’éternel retour des saisons, pour se persuader que rien ne viendrait contrecarrer irrémédiablement le renouvellement des générations, il fallait bien inventer des récits et justifier des rites étranges. Bélier ou taureau signifient à travers le monde cette puissance génésique qui est bien celle de la Terre-Mère ou de la Grande Mère. Les mariages divins donnent confiance aux hommes. Saintes familles ? Oui, mais les dieux et les héros sont parfois des voleurs de femmes et des violeurs, comme le prouve l’histoire de Déméter et de sa fille Coré enlevée par Hadès, dont l’heureuse conclusion aboutit au partage de l’année en deux périodes (si le grain ne meurt…), ce qui revient à reconnaître le droit du violeur ! Après le deuil de l’univers entraîné par la passion d’une vierge et la mort réelle ou symbolique de l’adolescent divin, se lève le jour de la résurrection. En Arcadie, c’est la déesse mère elle-même qui est violée par l’étalon Poséidon et se réfugie dans une caverne où rien ne peut pousser. En effet, la Bonne Mère risque de devenir la « Grondante » (Brimô) comme à Eleusis, ou encore Erinys qui incarne la froide vengeance en Arcadie.
La nature n’est pas toujours clémente dans ces contrées. Les Arcadiens m’ont dit que l’eau du Styx, cette eau noire (Mavronero) qui coule goutte à goutte sur un escarpement rocheux près de Nonakris, dont je parle dans mon Enquête (VI, 74) est aussi corrosive que le Coca-Cola de l’Oncle Sam, puisqu’elle brise tous les objets et ronge toute chose, excepté la corne des sabots des ongulés… et l’épiderme d’Achille, semble-t-il. Les célèbres « catavothres », ces gouffres creusés dans les plateaux calcaires, sont-ils l’œuvre d’Héraclès qui voulait drainer les marais ? Je ne sais. Si les hommes n’entretiennent pas les catavothres avec autant de soin que les digues de l’Euphrate ou celles du Rhône, l’inondation fait pourrir les récoltes et ruine le fondement des maisons. L’équilibre du sec et de l’humide est toujours délicat, puisque j’ai parcouru la plaine de Sanga qui porte le nom de « Plaine Stérile » . L’Arcadie que j’ai connue n’était faite que de bourgades rurales convoitées par leurs puissants voisins d’Argolide ou de Laconie. Un jour peut-être, elles s’uniront et leur confédération pourra s’enorgueillir du passé prestigieux de Tégée, la Protectrice, qui sut tenir la dragée haute à Lacédémone (I, 65-68 et IX, 26-28).
J’ai dit que l’Arcadie était le pays des Géants. La formule est sans doute un peu ronflante, puisqu’il est fréquent que l’on retrouve, en Grèce, dans le désert libyen ou sur les bords de l’Oronte en Syrie, des ossements gigantesques comme ceux d’Oreste que les Lacédémoniens devaient retrouver pour triompher des Tégéates. Je ne me permettrai pas de mettre en doute la véracité d’Homère qui considère les Géants comme les mortels d’autrefois, mais j’avoue ne pas savoir où se déroula le combat des Géants et des Dieux, en Arcadie ou dans la presqu’île de Cassandra en Chalcidique. Les légendes arcadiennes revendiquent une ancienneté aussi reculée que celle des Cécropides d’Athènes. Comme j’ai une tendresse particulière pour tout ce qui garde le souvenir des Pélasges, je citerai d’abord Pélasgos, fils de la Terre, plus vieux que la Lune, aussi utile pour l’humanité que Prométhée, puisqu’il lui a donné la cabane, la peau de mouton et les glands du chêne. Il fallait en passer par là avant de connaître, grâce à Arkas, leur héros éponyme, les maisons, les vêtements tissés et le blé. Mais je n’oublie pas Lycaon, le fils de Pélasgos, fondateur de Lycosoura (la Queue du Loup) et du culte de Zeus Lykaios qui, dit-on, prive de leur ombre ceux qui pénètrent dans le saint des saints de son sanctuaire. Les Arcadiens veulent-ils dire tout simplement qu’il les met à l’ombre, ou qu’il en fait des ombres privées de la lumière du soleil ? Il semble que Zeus pouvait se fier à la piété des Arcadiens, puisqu’un simple fil de laine suffisait à les dissuader d’entrer dans le sanctuaire de Poséidon fondé par les architectes du premier temple d’Apollon à Delphes (Pausanias, VIII, 10). À tout prendre, l’histoire de cette barrière symbolique est plus crédible que celle du cheveu de Méduse qu’Athéna avait donné comme talisman aux Tégéates pour que leur cité fût à jamais imprenable. Encore Pausanias (VIII, 47) qui, je le constate, n’est pas plus avancé que moi. Je lui dois de mieux comprendre aujourd’hui la signification de la légende de Lycaon (VIII, 2). Si tu dis que l’homme est un loup pour l’homme, songe au législateur de Sparte, Lycurgue dont le nom se réfère sans doute aux « œuvres du loup ». En tout cas, Lycaon est devenu loup après avoir sacrifié un nouveau-né, alors que Cécrops, son contemporain athénien, voulait proscrire tous les sacrifices d’êtres vivants et recommandait de n’offrir aux dieux que des gâteaux ! D’autres légendes arcadiennes m’étonnent. Je m’interroge en vain sur le visage noir de certaines déesses chez les Grecs. Comment peut-on croire qu’Aphrodite soit parfois noire parce que les hommes, contrairement aux animaux, font l’amour la nuit ? C’est pourtant ce que suppose le vertueux Pausanias. À Phigalie, c’est Déméter qui est noire comme la terre nourricière de la plaine d’Éleusis. À Kaphyai, dont les habitants m’avaient accueilli si aimablement en lavant mes pieds et en remplissant ma gourde, je me suis dit qu’ils avaient bien raison de considérer que la vieillesse de leur platane (planté par Ménélas !) est aussi miraculeuse que celle du gattilier (Agnus castus) qui pousse dans le temple d’Héra à Samos, du chêne de Dodone d’où sortit le navire Argo ou de l’olivier de l’Acropole. Près du site de la future Mantinée, j’ai vu la tombe de Pénélope. Je suis surpris qu’elle ait un jour cessé de faire chanter la navette dans le palais d’Ithaque. Ne pouvant admettre qu’elle ait fauté avec les prétendants, ce qui lui aurait fait rejoindre la troupe des épouses répudiées, je me plais à imaginer ses récriminations quand Ulysse, à peine revenu chez lui, l’obligea à l’accompagner dans le Péloponnèse où il voulait retrouver ses compagnons d’armes et savoir ce qu’ils étaient devenus. Ne sois pas étonné que l’on ne parle jamais de la tombe d’Ulysse !
Mais je ne veux pas quitter l’Arcadie sans dire mon émerveillement quand j’ai découvert, en m’écartant de la route qui conduit aujourd’hui de Karytaina (autrefois Brenthé), perché sur un piton rocheux qui surplombe l’Alphée, à Andritsaina, le chantier du temple de Bassai (Vassi-Phigali) consacré à Apollon Secourable. J’ai fait une mauvaise rencontre sur un sentier étroit obscurci par la poussière et encombré de rochers. Je somnolais sur mon ânesse quand vint à ma rencontre un rustaud monté sur une haridelle dont l’apparence était aussi déplaisante que celle de son maître. Ce n’était pas un bandit de grand chemin, mais un triste sire fort mal embouché qui prétendait qu’on lui cède le haut du pavé si j’ose dire. Allions-nous rejouer la scène de la rencontre fatale entre Laïos et Œdipe ? Mon humeur pacifique rendait la chose impossible. Ni voies de fait, ni moqueries, un simple geste pour que ma monture accepte de faire un pas de côté.
En revanche, j’ai bien failli connaître le triste sort des hôtes de l’Auberge Rouge. Je dois mon salut à une pauvre servante qui, prise de remords, avait décidé de ne plus servir les entreprises coupables de ses maîtres. Tu me dis que ton père qui cherchait dans un village des Cévennes le gîte et le couvert pour sa famille sortit précipitamment d’une auberge en criant « Sauve qui peut ». Que les habitants de Sauve nous pardonnent. En tout cas, le temple de Bassai mérite bien le détour et quelques péripéties. Un véritable joyau dans son écrin de verdure enserrée par la rocaille, que ne dépare aucune construction avoisinante, comme celui de Ségeste en Sicile. J’espère que tu pourras encore admirer le toit que l’architecte promet de construire en pierre. Sache que l’architecte n’est autre que celui du Parthénon, Ictinos, si l’on en croit les Phigaliens.
La Messénie et la Pylos des sables
Me voici en Messénie. Une plaine bien plus large et bien plus fertile que celle de l'Eurotas spartiate dont le brouet ne nourrit guère que des lauriers roses et des crapauds, des murailles parmi les plus belles que je connaisse, si impressionnantes qu'on se demande pourquoi la puissance qui domine dans le sud du Péloponnèse n'est pas Messène, l'ennemie irréductible de l'orgueilleuse Lacédémone à laquelle elle donna souvent du fil à retordre, parce qu'elle était peuplée de paysans qui ne rechignaient pas à l'effort, même quand il leur fallait abandonner leurs champs pour partir sur le sentier de la guerre. Je vais te faire entendre une fois de plus la voix des vaincus en célébrant le chef des Messéniens. Au cours de la deuxième guerre de Messénie, Aristomenès, qui descendait des anciens rois de Messénie, a pu célébrer à trois reprises la mort de cent Spartiates avant d’être vaincu lors de la « bataille de la Grande Tranchée », parce que son allié Aristocratès, le roi des Arcadiens, l’avait trahi. À trois reprises aussi, les Spartiates virent s’échapper celui qu’ils considéraient comme une bête de proie, maléfique et pleine de fourberie, aussi martial qu’Achille, aussi rusé qu’Ulysse et que le trickster de tous les folklores. S’il lui arrive de perdre son bouclier, ce n’est pas au cours d’une fuite éperdue comme le poète Archiloque de Paros, mais parce qu’il doit l’abandonner aux Dioscures, après la bataille de la Tombe du Sanglier (nous sommes en plein western !). Ce fut le seul moment où il perdit la tête, frappé de stupeur par l’apparition terrifiante des jumeaux divins, sous la forme de deux statues, de deux poutres de bois traversant le ciel ou de deux aigrettes verdâtres ou violacées comme les feux de Saint-Elme. Tu sais ce qu’il en est des luminescences que l’on observe parfois à l’extrémité des mâts des navires. Ces météores proviennent d’une décharge qui illumine les molécules de l’air ambiant parce qu’un champ électrique relie la mer et l’atmosphère. Elme provient d’une déformation italienne du nom d’Erasme, non pas l’humaniste, mais un Saint protecteur de l’Occident selon le Moyen Âge. Mais un nom venu du fond des âges, « Feu Sainte-Hélène », dit sans ambages que le présage n’est pas de bon augure.
Revenons à Aristomenès. Il récupère son bouclier pour le consacrer à Athéna, la déesse de la maison de bronze en Laconie, puis dans l’antre de Trophonios à Lébadée (Livadia). Bouclier magique qui reparaîtra bien plus tard pour terroriser les Spartiates quand ils seront vaincus par les Thébains en Béotie à Leuctres (371). On dit qu’après l’avoir tué ils ouvrirent son corps et découvrirent que son cœur était velu. Mais je me refuse à croire que la haine des Spartiates ait pu les entraîner à commettre pareil sacrilège. Quant à cette histoire de cœur velu, quelle absurdité, sauf si l’on admet qu’il s’agit d’un langage symbolique visant à signifier qu’Aristomenès avait quelque chose du loup, du renard ou du singe, du moins selon la propagande des Spartiates ! Je préfère croire les Rhodiens qui disent qu’il s’est exilé chez eux et fut à l’origine d’une famille illustre, celle des Diagorides.
Je n'approuve pas que les Spartiates confinent les vaincus et les autres populations laconiennes dans un statut inférieur, à la périphérie du centre comme l'indique le nom de périèques, ou comme les hilotes qu'ils font trimer dans leurs ergastules ou derrière le soc de leurs araires, quand la jeunesse dorée n'exerce pas ses muscles en les massacrant à coup de gourdins ! Je proteste et je souhaiterais que la dignité de tout homme soit reconnue. Mais je n'ignore pas que chacune de nos cités, et Athènes plus que toutes, doit sa prospérité et son bonheur au travail des esclaves. Tous n'ont pas la chance de bénéficier d'un bon maître comme le porcher Eumée dont tu connais l'histoire. Il est à craindre que les hommes ne renonceront pas à se faire la guerre, cette grande pourvoyeuse d'esclaves. La servitude changera de forme, il y aura d'autres révoltes, bien plus graves que celle des hilotes, il y aura aussi des « sous-hommes » qui relèveront le défi, redresseront la tête et auront la même fierté que le fabuliste Ésope ou le philosophe Épictète.
Je n’ai pas eu la chance de Télémaque. Aucun descendant du vieux Nestor ne pouvait m’accueillir en son palais. De mon temps, la Pylos des Sables n’était plus qu’une bourgade insignifiante située près de Koryphasion, sur la côte Nord de cette baie sablonneuse où plus rien n’affleurait. La baie est protégée des vagues venant du large par une langue de terre insulaire, Sphactérie, où les Athéniens ont établi récemment une garnison et un gourbi pour les guerriers lacédémoniens vaincus par Cléon. Je ne puis proposer ici qu’un récit conjectural, truffé de légendes invérifiables et d’hypothèses que les découvertes de vos archaiologoi paraissent confirmer. La Pylos de Nestor se trouvait-elle sur la côte Sud de la baie, plus exactement à proximité de ce que l’on appelle la grotte de Nestor ? À mon époque, nous en discutions sans rien savoir, et la ville de Nestor était pour nous aussi mystérieuse que la ville du roi d’Ys, le site de Tombelaine dans votre baie du Mont Saint Michel, ou la ville vendéenne de Belesbat que l’on imagine proche de Jard sur mer. Il semble qu’une fois de plus nous approchions des Enfers, comme le dit Bernard Sergent. Tombe d’une Hélène aux chevaux d’or, fille d’un roi breton, Hoël, victime de la lubricité d’un géant venu d’Ibérie ? Caillou jeté par Gargantua ? Mais ce Grand Poucet en a tellement semés qu’il faudrait le suivre à la trace à travers tout le pays gallique. Tombe de Belenus, Bélial ou Belzébuth enseveli par l’archange Saint Michel, comme au Monte Gargano dans l’éperon de la botte italienne, quand une autre religion s’est avisée de donner une nouvelle signification aux sites les plus anciens ? À toi de démonter, sans te laisser duper, cette machinerie imaginaire, ce savant bricolage, ce recyclage incessant qui veut faire échec au temps et lâche la proie du présent pour l’ombre en creusant des interstices où viennent se glisser les fantômes du passé. Alors, Nestor devient notre prochain et sa voix de bronze a encore quelque chose à nous dire.
Nestor vécut assez vieux pour voir périr ses enfants et ses petits-enfants, mais, peu de temps après lui, la cité sombra dans l’oubli. Héraclès, ou les Héraclides revenus du Nord, sont dénoncés comme les responsables de cette catastrophe et les mythographes accumulent les récits comme autant de preuves. On nous raconte que le fondateur de Pylos, le Minyen Nélée avait refusé de purifier Héraclès après le meurtre d’Iphitos. D’autres disent qu’il s’était allié à Augias dont Héraclès nettoya les écuries en détournant l’Alphée, ou encore qu’il s’était emparé du troupeau de Géryon, comme certains « héros » de vos westerns. Héraclès en aurait profité pour se venger de sa mère Héra qui l’avait privé de son lait et lui infliger le poison d’une flèche trempée dans le sang de l’hydre de Lerne. Curieux tueur de monstres qui n’hésite pas à hériter de leurs pouvoirs maléfiques ! J’ai déjà évoqué le pouvoir des cheveux de la Méduse. Eh bien, Héraclès, voulant obtenir que le roi de Tégée devienne son allié, aurait donné à sa fille une tresse de ces cheveux en lui disant de la brandir trois fois du haut des murailles, sans la regarder, pour rendre la ville inexpugnable.
Et Sparte ?
Eh bien, je n’ai pas visité Lacédémone. Si j’en crois les voyageurs, il est assez surprenant de constater que Sparte n’est qu’un agglomérat de villages aux murailles plus ou moins décrépites. Mais la Muse de l’histoire et mes lectures m’auraient permis de surmonter ces impressions désagréables et de faire la part des choses. Aujourd’hui, une partie de la jeunesse athénienne est fascinée par Sparte, son régime politique qu’elle considère comme un modèle d’équilibre politique, puisqu’il repose sur une double monarchie contrôlée par les gérontes et des surveillants scrupuleux, les éphores, sur une éducation rigoureuse et sur un dévouement total à la cité. Mais la plupart des Athéniens préfèrent évoquer la folie suicidaire d’un impie, Cléomène, ou les rois qui se laissent corrompre, la xénophobie des Spartiates, les souffrances des hilotes et l’incohérence d’une éducation qui soumet les enfants aux exactions de leurs aînés et leur apprend à voler pour survivre. J’avoue ne pas comprendre qu’un enfant ait pu se faire dévorer par un renard qu’il dissimulait sous sa tunique pour dissimuler qu’il l’avait volé. Je ne sache pas que le renard fasse partie des animaux domestiqués. J’approuve Périclès de préférer des mœurs plus douces et des relations plus tolérantes entre les citoyens. Pour ma part, je répugne à l’embrigadement et, plutôt que de me laisser impressionner par le brillant palmarès des Olympioniques Lacédémoniens, j’examine le revers de la médaille. Comment se fait-il que les artistes et les écrivains semblent avoir déserté la Laconie ? Faut-il accuser le régime militarisé instauré par Lycurgue ?
Petit discours olympique pour démontrer mon impartialité
J’aurais aimé suivre les traces de Télémaque et démontrer en prenant la parole au cours d’un banquet que j’étais parfaitement capable de rendre hommage à la vertu des combattants de Platées. Les circonstances politiques ne s’y prêtaient guère et j’aurais pu passer pour un agent des démocrates athéniens qui venait les narguer. Je n’ai pas relevé le défi. Mais j’avais d’autres occasions qui me permettaient de démontrer mon impartialité quand j’évoquais les rapports entre Sparte et Athènes. Ce fut le cas à Olympie, au moment où je m’apprêtais à quitter le Péloponnèse. Ce jour-là, plutôt que d’éparpiller mon logos de cité en cité, j’ai choisi la voie la plus rapide, j’ai frappé un grand coup qui me permettait d’économiser mon éloquence. Lucien de Samosate * a bien raison d’insister sur les raisons pour lesquelles j’avais choisi cette panégyrie où se rassemblent des Grecs de toute origine. J’accepte qu’il fasse de moi une espèce de sophiste soucieux, dès le départ, comme Hippias, Prodicos et beaucoup d’autres, de devenir célèbre en improvisant sur ce qu’il avait écrit. Il devrait citer Gorgias qui me ressemble encore davantage. Comme le chien Diogène (je veux dire le Cynique), qui, selon le neuvième discours de Dion Chrysostome, assista aux Jeux de l’Isthme, je me disais que, dans les panégyries, les hommes révèlent plus clairement leur vrai caractère qu’en temps de guerre et dans les camps où ils le dissimulent parce qu’ils ont peur des risques de la guerre. Je n’avais pas l’audace de revendiquer ironiquement une couronne olympique, en prétextant que j’avais vaincu des adversaires particulièrement coriaces, l’exil, la pauvreté et la mauvaise réputation, comme le fait Diogène.
Pourtant, à ma manière, je suis devenu un Olympionique, plus rusé que les lutteurs de pancrace et les conducteurs de char, puisque je n’ai pas vraiment joué le jeu. En marge des Jeux, j’ai choisi un sujet qui me permettait de rendre hommage à tous les libérateurs, sans dissimuler les divergences qui se manifestaient à propos de l’avenir des îles et des cités grecques d’Asie Mineure ou des relations avec l’empire perse qui, j’en étais convaincu, n’avait pas subi de défaite irrémédiable. Ce n’était donc pas un panégyrique dans le sens où vous l’entendez aujourd’hui. Voici à peu près ce que j’ai osé dire (je n’ai pu m’empêcher de glisser quelques anachronismes), dans le gymnase de l’Altis, tandis que Borée faisait bruire le feuillage des peupliers argentés, devant une foule composite qui était surtout venue pour se goberger et applaudir bruyamment les athlètes :
« En ce jour où les Grecs, oubliant leurs querelles, honorent Zeus et Déméter qui, par sa présence tutélaire sur les deux champs de bataille de Platées et de Mycale, est venue au secours des combattants de la liberté, je cède bien volontiers aux sollicitations de mes auditeurs qui souhaitent que je leur raconte l’épilogue de notre Grande Guerre. Mais je n’ai pas l’intention de célébrer une fois de plus Salamine et Platées, ni même de composer à votre intention un énième récit de bataille, comme j’ai su le faire. Je ne me considère pas comme un spécialiste de la chose militaire, et l’échec des Perses sera toujours pour moi un miracle que je n’arrive pas à expliquer. Je lis pourtant, sous la plume de certains de vos savants, des explications qui me laissent pantois : ce ne serait pas la vaillance des Grecs, mais les faiblesses de l’ennemi incapable de concevoir une stratégie navale qui expliqueraient l’échec des Perses. Ils disposaient tout de même, avec les Phéniciens et les Ciliciens, de marins compétents et je ne sache pas qu’il y ait eu chez eux plus de traîtres que dans nos rangs. Mais il est vrai qu’avant Mycale les Perses se sont dit qu’ils ne pouvaient se risquer à engager le combat sur mer, ce qui contraignit les Grecs à s’engager sur terre pour attaquer le camp où les Perses s’étaient retranchés avec leurs navires.
« J’espère que mon récit vous permettra d’apprécier les mérites de chacun des peuples et de comprendre ce qui s’est passé. C’est tout de même plus éloquent qu’une inscription mortuaire ou dédicatoire, qui parfois s’avère mensongère et suscite la méfiance de l’enquêteur. En ce jour de l’an de grâce 479 (oui, je jongle avec les calendriers !), les Grecs ont fait mieux que planter l’arbre splendide de leur liberté, comme ces arbres de la Liberté que les Chouans osaient parfois déraciner pour dénoncer l’abus de langage des Révolutionnaires qui brûlaient leurs villages et leur donnaient le nom de Brigands. Il faut continuer à planter des arbres de la Liberté, dans les lieux où l’on forme les jeunes (il y en a un sur le campus de Nanterre) et sur vos places, mais à condition que ce mot ne soit pas un paravent mensonger.
« Mais l’arbre dont je parle, si beau soit-il, ne doit pas cacher la forêt, ni faire oublier le sang versé et l’obscurité des sous-bois où les hommes, les nôtres et ceux d’en face, se débattent de manière pitoyable pour échapper aux coups d’estoc et de taille et aux conséquences d’une défaite qui ferait d’eux des esclaves. Tout comme il est nécessaire que les végétaux se décomposent pour nourrir les racines des arbres, il faut bien se dire que les belles actions, celles que les orateurs célèbrent, et ce que les générations futures appelleront le miracle grec, ont besoin, pour fleurir à ras de terre, de s’enraciner dans ce que l’humanité a de plus humble et de plus laid. Guerre ou paix, peu importe, rares sont les hommes qui oublient de satisfaire leurs petites passions, appétit sexuel, vengeances dérisoires, larcins en tout genre, manœuvres douteuses pour profiter des circonstances, dénonciations calomnieuses, rien ne nous est épargné de part et d’autre. J’aimerais pouvoir célébrer tous les combattants qui ont épargné la vie de celui qui les menaçait, chacun des chefs qui a su honorer le courage de l’ennemi et s’opposer à la mutilation des cadavres. Je dédie mon discours à tous ceux qui n’ont pas d’épitaphe.
« Imaginez l’armée fantomatique des soldats perdus et affamés, conduite par un Grand Roi qui n’est plus que le Général d’une armée morte. Je force un peu le trait parce que je songe au livre d’Ismaïl Kadare *, à ce général albanais qui est chargé d’exhumer les squelettes de ses compatriotes pour les rendre à leurs familles. L’armée de Xerxès ne laisse rien derrière elle, ni fourrage, ni feuillage. Elle n’est plus qu’une horde de quadrupèdes qui rampent dans les broussailles, et les Grecs se demandent ce qu’ils doivent faire pour parachever leur victoire. Une fois de plus, je dois faire alterner mon récit en passant des Perses aux Grecs, en passant des opérations sur terre aux opérations sur mer. La fuite éperdue de Xerxès, des plaines thessaliennes jusqu’à l’Hellespont, dura quarante-cinq jours. Je ne suis pas sûr qu’il ait voulu passer à nouveau sur le pont de bateaux qu’il avait construit et que le Dieu de la tempête se soit chargé de détruire le pont, alors que Thémistocle avait dissuadé les Grecs de le détruire en leur disant qu’il partirait plus vite (VIII, 110). Je suis sûr en tout cas qu’il est passé par Abdère et que de nombreux Perses sont morts parce que la disette, suivie de ripailles excessives une fois qu’ils disposèrent de vivres plus abondantes, les avait affaiblis. Au cours de la retraite, le Perse Artabaze dissimula la défaite de Platées aux Thessaliens qui ignoraient ce qui s’est passé (ce n’est pas invraisemblable).
« Le jour même où le désastre frappait à Platées (le mot que j’emploie, trauma, signifie plus précisément « blessure »), les Perses furent aussi frappés à Mycale en Ionie. Je suis soucieux de rendre hommage au roi de Sparte, Leutychidès, mais aussi aux Samiens qui vinrent le trouver pour lui demander de libérer les Ioniens. Ne les accusez pas d’avoir volé au secours de la victoire ! Dans mon récit de la révolte ionienne, j’ai sagement renoncé à distinguer parmi les cités celles qui furent preuve de lâcheté ou de courage (VI, 14). Comme je l’ai dit dans le récit de la révolte ionienne par le truchement de Dionysios qui gouvernait les Phocéens, les Ioniens étaient « sur le fil du rasoir ». Beaucoup avaient fait le choix de la révolte, mais ils n’étaient pas unanimes en ce qui concerne le choix des moyens et Dionysios fut obligé de condamner leur refus de s’entraîner et leur indiscipline (VI, 11). Si vous vous demandez pourquoi je déroge ainsi aux bons usages de la rhétorique du blâme et de l’éloge, je répondrai en citant l’exemple des Samiens. Certains de leurs triérarques ont refusé de suivre les ordres de leurs chefs et ont continué le combat. Quant aux habitants de Chios, ils ont payé bien cher leur courage. Pour signifier que toute guerre met les hommes au pied du mur et les précipite dans des situations bien complexes, j’ai même inventé une troisième catégorie, celle des gens qui pratiquent la lâcheté volontaire, parce qu’ils sont contraints de faire une guerre qui n’est pas la leur. Il faut parfois savoir attendre des jours meilleurs.
« Je sais qu’il est toujours possible, avec le recul des ans, d’ironiser amèrement sur la versatilité des peuples et leurs choix successifs. Sur le cap Mycale, pourtant, les Ioniens, pour une fois réunis, avaient dédié le sanctuaire de tous les Ioniens à Poséidon. Confrontés aux Perses, ils ne pouvaient préserver cette unité. Ceux des îles s’en tiraient un petit peu mieux. Ils pouvaient contribuer à l’effort de guerre des alliés.
« Que faire des Ioniens ? Ce fut la grande question quand la guerre prit fin. Fallait-il les inciter à se lever en masse pour rejeter le despotisme ? Je suis bien obligé de souligner que les divergences qui se sont manifestées alors entre Péloponnésiens et Athéniens n’ont pas fini d’entraîner de fâcheuses conséquences, d’autant plus qu’Athènes n’est guère respectueuse de l’autonomie des cités ioniennes et oublie les sages conseils d’Aristide. Ce qui pouvait passer pour une saine émulation au cœur de la bataille, chacun voulant jouer le premier rôle, n’avait rien d’inquiétant. Chacun jouait sa partie, mais les rôles avaient été sagement définis. En revanche, après la bataille, les mots fusèrent de part et d’autre, manifestant un profond désaccord. En général, les Grecs se rendaient bien compte qu’ils ne pourraient assurer de manière durable la protection des Ioniens et que, s’ils ne le faisaient pas, les Ioniens échoueraient dans leur combat libérateur (VI, 106). Mais cela n’empêcha pas les Athéniens de se diriger vers l’Hellespont et d’assiéger Sestos, alors que Leutychidès prenait la décision de repartir vers la Grèce. On vit bien alors à quel point la prudence des Péloponnésiens s’opposait à l’esprit d’entreprise des Athéniens. Puisse l’éclat de nos victoires ne pas nous aveugler au point de ne plus voir les nuées qui s’amoncellent, les divergences qui nous séparent et la menace perse toujours présente pour nous intimider, pour asservir certains d’entre nous ou pour nous séduire. À bon entendeur salut ! »
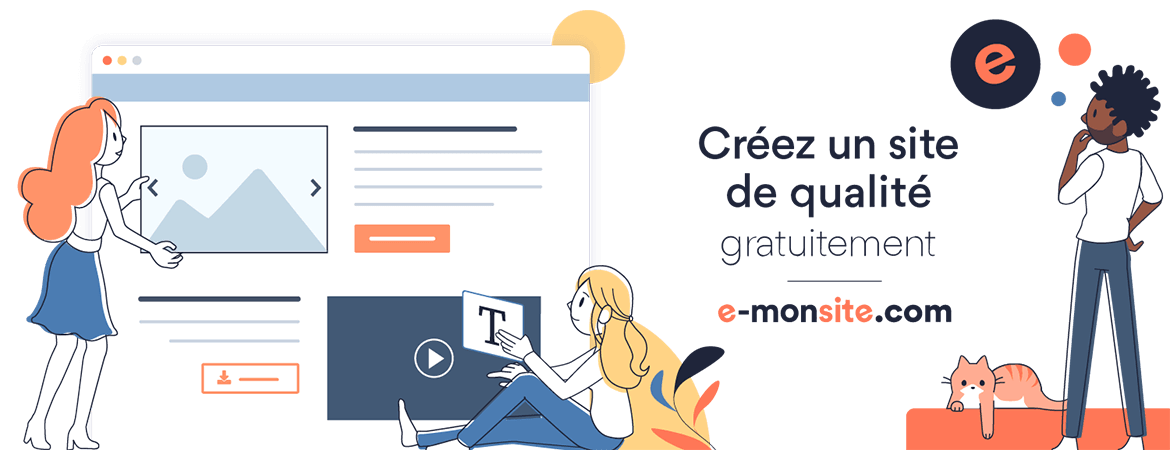





Ajouter un commentaire